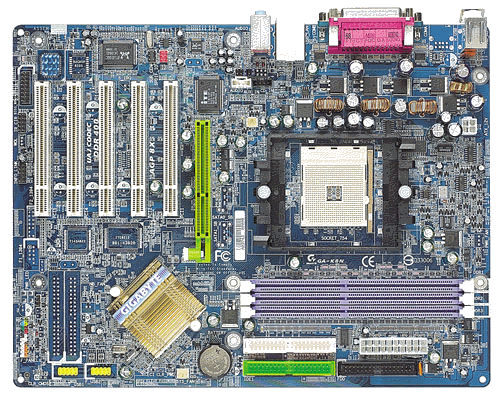m’offre un café à la distributrice et comme deux autres personnes attendent leur tour le voilà à payer la tournée. Il s’était préparé un chocolat, qui fume dans son gobelet sur le comptoir; l’un des messieurs dans la file tend le bras, “C’est pour moi le chocolat?” et H. n’ose pas dire que c’est le sien. Pas si fréquent d’apercevoir la mince couche de timidité sous le vernis du vieux routier.
m’offre un café à la distributrice et comme deux autres personnes attendent leur tour le voilà à payer la tournée. Il s’était préparé un chocolat, qui fume dans son gobelet sur le comptoir; l’un des messieurs dans la file tend le bras, “C’est pour moi le chocolat?” et H. n’ose pas dire que c’est le sien. Pas si fréquent d’apercevoir la mince couche de timidité sous le vernis du vieux routier.
 a collection d’albums de coloriage marche très bien, paraît-il. “Tu as du nez! On n’y croyait pas. On va lancer une série sur les légendes du Moyen-Age.” Dommage. J’aimais plutôt les séries sur le patrimoine, les régions, les villes, les paysages. Des heures à remplir chaque toute petite zone d’un village d’Alsace, tuile après tuile. Ou chaque détail d’un paysage de champ de choux-fleurs: quand maman est morte, il n’y a pas eu tellement de choses que j’arrivais à faire pour ne pas passer mon temps à sangloter dans le jardin. H. n’en sait rien.
a collection d’albums de coloriage marche très bien, paraît-il. “Tu as du nez! On n’y croyait pas. On va lancer une série sur les légendes du Moyen-Age.” Dommage. J’aimais plutôt les séries sur le patrimoine, les régions, les villes, les paysages. Des heures à remplir chaque toute petite zone d’un village d’Alsace, tuile après tuile. Ou chaque détail d’un paysage de champ de choux-fleurs: quand maman est morte, il n’y a pas eu tellement de choses que j’arrivais à faire pour ne pas passer mon temps à sangloter dans le jardin. H. n’en sait rien.
 n huit heures de rang dans la même salle, pas un seul souvenir du jour où on avait regardé son dossier. C’est en redescendant que ça m’est revenu, parce que je comparais l’ambiance claire que lui donnent désormais les peintures beiges et bleues avec l’atmosphère de vieil aquarium sale qui y régnait autrefois, même en plein soleil, sans doute à cause des peintures jaunes et vertes. Ou orange? Je ne sais plus.
n huit heures de rang dans la même salle, pas un seul souvenir du jour où on avait regardé son dossier. C’est en redescendant que ça m’est revenu, parce que je comparais l’ambiance claire que lui donnent désormais les peintures beiges et bleues avec l’atmosphère de vieil aquarium sale qui y régnait autrefois, même en plein soleil, sans doute à cause des peintures jaunes et vertes. Ou orange? Je ne sais plus.
–
Lettrines en BD Renaissance de Streetwise Software - sur Dafont.
Virgile
Musil
Rien n’est plus révélateur que l’expérience involontaire de ces tentatives, érudites et raisonnables, pour expliquer l’oeuvre de ces grands essayistes, pour transformer leur sens de la vie, tel qu’ils l’exposent, en une théorie de la vie (…); de tout cela, il ne reste guère plus alors que la délicate architecture de couleurs d’une méduse après qu’on l’a tirée de l’eau et déposée sur le sable. Dans la raison des non-inspirés, la doctrine des inspirés tombe en poussière, contradictions et non-sens : pourtant, il ne faut pas dire qu’elle est délicate et incapable de vivre, ou alors il faudrait dire aussi d’un éléphant qu’il est délicat, puisqu’il ne peut subsister dans un espace privé d’air et qui ne répond pas aux exigences de sa nature.
Swann
Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre!
–
Virgile c’est sur http://www.etudes-litteraires.com/roue-virgile.php; Musil c’est dans L’homme sans qualités, Points-Seuil, tome 1, p. 305; Swann c’est l’excipit d’Un amour de Swann.
L’université est stupide. Elle n’enseigne qu’à aller de la fable à la pensée, ou de la pensée à la fable. Au mieux, pour les meilleurs, elle suggère comment aller de la pensée à la pensée. Mais il faudrait aussi qu’elle apprenne à naviguer de la fable à la fable… sans cesser de penser.
Des histoires de cette sorte, il ne suffit pas de les conter, il faut aussi compter l’heure qu’elles sonnent, dresser l’oreille : où en est-on ? Des événements vient un avertissement qui autrement ne serait pas tel. Ou plutôt : un avertissement déjà présent prend de petits événements pour traces et pour exemples. Ils indiquent un plus ou un moins qui est à méditer en racontant et à raconter en méditant (…) Beaucoup de choses ne se comprennent que dans des histoires de ce genre et non dans un style plus ample et plus relevé. (…) Ce qu’on va maintenant essayer de conter, de faire remarquer, c’est comment on a été frappé par certaines choses. En connaisseur, on remarque en racontant, en remarquant, on dit ce qu’on veut raconter.
Rien à voir avec la première gorgée de bière et d’autres plaisirs minuscules. Ce n’est pas ici qu’on veut rester, mais là-bas qu’on veut aller. Par ici.
Ce sont souvent les impondérables et les bizarreries qui vont le plus loin. (…) Il est bon de penser aussi par fable.
–
Ernst Bloch, Traces (Spuren, 1932), dans la trad. de Quillet et Hildenbrand aux “Essais” chez Gallimard, p. 14 sq.
Y’a les salles miteuses avec des tables de cours vaguement mises en carré et les gobelets en plastique qui traînent au fond, et y’a les amphis de luxe avec des boiseries et des micros.
Y’a les chaises de classe en bois dur qui fait mal aux fesses au bout de deux heures et y’a les auditoriums avec des fauteuils rouges comme au théâtre.
Y’a les fenêtres qui donnent sur des paysages, des banlieues ou des centres-villes ou des bois de hêtres ou des fleuves ou des nuages, rien que des nuages, quand c’est très haut dans une tour, et y’a les salles qui ne donnent sur rien, qui n’ont pas de fenêtre, où la lumière est tout le temps allumée.
Y’a les publics qui ne disent rien mais qui notent, ceux qui ne disent rien et ne notent rien, ceux qui parlent pour dire des conneries, ceux qui parlent pour dire des choses intéressantes.
Et à la fin il ne reste rien.
–
Photo © E. 2006
A huit heures sept, au dernier feu rouge avant d’arriver, je me dis que je n’aurai pas le temps de prendre un café et une cigarette avant le premier cours, et que c’est tant mieux, je fumerai moins. Et puis finalement je le prends quand même. C’est plus compliqué qu’avant, on ne peut plus fumer dans les bureaux. Et finalement tant mieux, quand j’arrive tout est déjà installé.
A douze heures trente-et-une je calcule le temps dont je dispose pour revenir à la maison pour manger avant de reprendre une heure plus tard, et le résultat n’est pas très bon, un peu la course. Mais finalement je repars quand même. Rien que l’idée de manger un sandwich me donne la nausée. Je ne mange pas tellement mieux à la maison, mais au moins c’est chaud, et ce n’est pas un sandwich.
Je parviens de la sorte à ne croiser presque personne, à ne laisser les personnes chercher à me croiser que par messages ou formulaires posés dans mon casier, ou petits textos appelant un avis pour une décision immédiate. Je ne suis qu’à deux portes, ou quelques amphis de là, mais je ne croise personne, et c’est tant mieux. Les seuls visages auxquels je fais face ne me connaissent pas, et je ne les connais pas. Leurs caractères de dissolvent aisément dans les sujets que nous abordons.  Une revue musicale des Années Folles, un roman algérien, une scénographie improvisée des excipits de Sophocle et de Giraudoux, six (ou sept? je ne sais plus) références Gallica d’essais classiques, les cinq (ou six? quelle importance?) échelles possibles de la vulgarisation scientifique. On peut faire des allées-et-venues entre les cent mille portes d’entrée de la littérature comme on va-et-vient entre un bureau, la salle du courrier où se tient la machine à café, et les amphis A. Repeints de neuf, les amphis A, comme pour mieux oublier leur ancien nom triplement recouvert par la nouvelle nomenclature, les deux nouvelles personnalités embarquées dans leur baptême, et les grandes plaques très design surmontant leurs entrées à deux portes. Le couloir est tout blanc, tout propre. Le visage des lieux est moins diversifié, mais tout aussi neutre que celui des gens et des livres.
Une revue musicale des Années Folles, un roman algérien, une scénographie improvisée des excipits de Sophocle et de Giraudoux, six (ou sept? je ne sais plus) références Gallica d’essais classiques, les cinq (ou six? quelle importance?) échelles possibles de la vulgarisation scientifique. On peut faire des allées-et-venues entre les cent mille portes d’entrée de la littérature comme on va-et-vient entre un bureau, la salle du courrier où se tient la machine à café, et les amphis A. Repeints de neuf, les amphis A, comme pour mieux oublier leur ancien nom triplement recouvert par la nouvelle nomenclature, les deux nouvelles personnalités embarquées dans leur baptême, et les grandes plaques très design surmontant leurs entrées à deux portes. Le couloir est tout blanc, tout propre. Le visage des lieux est moins diversifié, mais tout aussi neutre que celui des gens et des livres.
–
Les schémas sont sur les pages personnelles d’E. Faou à l’INRIA. Le premier montre un résultat “without resonant stepsize” et le second avec. Je n’ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire, mais c’est indexé avec Schrödinger en mot-clé et je trouve ça presque plus joli que le Periodic Table Printmaking Project en fin de compte.
Je suis un peu déçue: malgré le choix d’un propulseur de blog indépendant, et tout ce qu’il faut apprendre pour s’en servir, l’informatique reste désagréablement au-delà de mes moyens et en-deçà, du coup, de mes petites idées. Par exemple, je ne trouve pas le “plugin” adapté à ma contrainte: les tags afficheront bien chacun des titres, dans les 17 semaines où ils apparaissent, mais je ne vois pas le moyen de faire apparaître les 17 titres d’articles / noms de tags en cliquant sur chaque semaine. Et globalement je sais bien que ça reste obscur: le tag cliqué renvoie à une “archive” (mot inapproprié) qui donne bien les titres des articles mais il faut regarder de près pour voir aussi le défilé des semaines. J’aurais voulu quelque chose comme des colonnes, peut-être, une représentation graphique rendant la contrainte et ses résultats plus évidents. Le “nuage de tags” aussi. Un joli truc sur les autres blogs qui n’en règlent pas l’apparition périodique, mais dans ce cas-ci ils adoptent finalement un comportement moins intéressant: ils gonflent au fil des jours jusqu’à ce que je les emploie tous, et à chaque début de semaine ils retournent tous au plus petit corps. Je comprends alors que le fameux “nuage” fonctionne par différentiel entre chaque tag; à la fin de chaque semaine on se retrouve au point zéro. Il aurait fallu une astuce qui puisse enregistrer leurs gonflements successifs et aléatoires, une sorte de série de clichés jour après jour qu’on aurait ensuite pu faire défiler, comme un flip-book.
Et puis je n’ai jamais réussi à faire glisser le titre dans le rectangle sombre de gauche.
Pourtant j’en ai appris, des trucs et des choses et des CSS et des PHP, des noms de balises et des codes de couleurs. On y est très bien aidé sur le réseau. L’honnêteté voudrait que la liste de liens “Outils” soit beaucoup plus longue. J’y pense. Mais je suis ennuyée par le fonctionnement du référencement: si j’ai bien compris, dès que je fais apparaître un lien ça me colle dans le “réseau” quantitatif du site vers lequel je pointe — mais je n’ai pas forcément envie de cette image communautaire en ouverture de mes gribouillis. Ça donnerait aux 17 semaines une identité de “blog worpress” qui n’est pas du tout la leur. Une fois de plus l’outil submerge de ses caractères propres le projet derrière lequel il devrait à peine se deviner. J’ai l”impression que ça arrive particulièrement souvent avec l’informatique mais on me rétorquera peut-être que c’est pareil avec, disons au hasard, la dissertation ou les foutus colloques de recherche. Est-ce ainsi que l’on se définit? Tu apprends pendant des années une technique, avec toute la persévérance ou l’acharnement pour la dominer, et à la fin, quand tu crois manipuler ton outil avec virtuosité, tu n’as fait qu’y adapter tous tes talents, de leurs racines à leurs ramifications.
Et lorsque je crois circuler avec aisance dans le labyrinthe des oeuvres d’art, peut-être que je ne fais que tourner la roue d’une dissertation infinie, comme un écureuil, sa cage.
L’image du réseau me plaisait bien. Réseau, branchage, pelote de fils emmêlés, radicelles, échangeurs d’autoroutes ou chevelure de comète. Comme image, c’est parfait, ça donne au journal l’échelle potentielle du fameux tableau à mille entrées. Mais je parierais que Barthes lui-même se serait découragé s’il avait tenté le codage idéal des quatre tables de S/Z ou des trois niveaux de marges des Fragments d’un discours amoureux… Sur des pages tu fais un compromis assez coûteux: chaque page est virtuellement pleine des liens à faire vers les autres pages, chaque table une possibilité de constellation, et une seule. Si tu veux vraiment aller jusqu’au bout du système des pages il te faut autant d’exemplaires du livre que des combinatoires désirées, pour arracher les pages et les disposer à loisir selon toutes les configurations qu’elles appellent. Le coup des Cent mille milliards de poèmes. N’importe quel Oulipien me coderait sans doute ma minuscule machine de contraintes en trois coups de cuiller à pot.
Comment se fait-il donc que l’Oulipo n’ait pas lancé un atelier de codage barthésien?
Dans les articles c’est encore moins clair. J’en prends conscience à mesure que le tableau de statistiques signale des visiteurs, et des qui reviennent encore: je suis bien obligée d’adopter, au moins le temps de considérer leur petite ronde dans quelques pages, leur point de vue probablement perplexe. Pas si facile de naviguer entre un titre, une image, un texte et leurs connotations éventuellement croisées ou multipliées. Me suis pas donnée de contrainte d’homogénéité à cette échelle-là, alors comment pourraient-ils deviner la “danse des grands singes”, ou la plaisanterie de fin de colloque du Swann, dans le zoo virgilien ou musilien? Mes connotations personnelles font, sur toutes ces journées, des cancers parfois marrants, parfois pas, et comme il y en a que je n’ai pas envie d’expliciter, même à moi-même, tout en souhaitant quand même en baliser les apparitions au fil de ces 17 semaines, ça continue de faire un sacré bordel.
Le dispositif du journal n’aide peut-être pas à dessiner des figures assez claires. C’est le contraire des tags. Ceux-là, je les aurais voulus buboniques, proliférants, gonflant des bulles et bouillonnant des polypes; mais ils sont sages comme des marées lunaires, seules leurs vagues quotidiennes laissent lire le hasard de leurs ressacs, tout effacés quand reprend le flux de la semaine. C’est dans les articles que ça se passe, les boules et les grosseurs, mais sans que le génie informatique puisse en tirer quelque graphique que ce soit. C’est encore trop le bordel; quel développeur, même génial, y trouverait la moindre logique de codage?
–
Dessins de lettres avec (dans l’ordre) Earwig Factory de Larabie Fonts, Planned Obsolescence de Vic Fieger, History Brush d’Atrax, Liquid Newspaper de uZiMweB et Inkburrow de UddiUddi — sur Dafont.
Après tout l’été passé à rédiger ces 596 pages à l’arrachée, j’aurais compris que la thèse n’était pas bonne ainsi, pas aboutie, et je ne l’aurais pas déposée. J’aurais résisté aux pressions, je n’aurais pas cédé à l’urgence de soutenir coûte que coûte avant décembre pour pouvoir candidater au poste qui se libérait. J’aurais eu confiance en moi, je me serais sentie capable de décrocher un autre poste, plus tard, l’année d’après ou celle d’après encore, ailleurs peut-être. Je ne me serais pas sentie obligée de tout faire, d’épuiser toutes mes forces, toute ma jeunesse, et de laisser filer toutes les intelligences de mon bébé d’un an, pour rester là.
Après avoir reçu par la poste, complètement imprévu, le dossier que l’archiviste de Gallimard avait constitué pour moi après cette entrevue dont j’étais pourtant ressortie si déçue, rue Sébastien-Bottin, j’aurais compris qu’avec du temps et de la persévérance, et quelques progrès dans ma façon de leur poser des questions, je pouvais en apprendre beaucoup des éditeurs, malgré leur goût du secret.
Après avoir reçu par la poste, décevant et merveilleux tout à la fois, le paquet que la secrétaire des éditions Suhrkamp avait confectionné pour répondre à ma lettre naïve, j’aurais compris plus vite deux choses: que mon questionnaire avait irrité le Grand Directeur, et qu’il avait malgré tout eu envie de m’encourager en me faisant expédier, en même temps que sa réponse cinglante, l’exemplaire hors-commerce d’hommage à Fleckhaus où se trouvaient toutes les réponses, même aux questions que je n’avais pas encore eu l’intelligence de poser.
Après avoir replacé dans les rayons de la BU les énormes livres de Massin, de Faucheux; après avoir rangé très haut dans ma bibliothèque les deux petits opuscules crème, en allemand, de Jan Tschichold, et commencé de remplacer ces lectures enchantées par les arpentages conceptuels d’Adorno ou de Goodman, sur lesquels je trébuchais sans cesse, j’aurais compris que je ne choisissais pas la bonne porte, que la théorie n’était pas la porte qui me convenait pour entrer dans le labyrinthe de la littérature.
Après Munich, après avoir compris que le projet était totalement irréalisable de cette façon-là, j’aurais pris quelques semaines pour réfléchir, peut-être quelques mois, et plutôt que d’abandonner les arts typographiques pour me réfugier dans la théorie j’aurais fait le contraire. J’aurais pris une inscription en histoire de l’art, ou en arts plastiques, en informatique. Les livres de ma bibliothèque auraient été différents, et d’ailleurs moins nombreux: j’aurais acheté des machines plutôt que des livres.
Je n’aurais pas écrit de thèse sans doute. Comment aurais-je pu me détromper, toute seule, de cette illusion? Je n’avais que vingt-six ans.
–
Screenshots extraits de http://text.jodi.org de Jodi, special thanks to E.
Chaque année à la même période, l’orbite de la Terre croise des nuages de poussières laissés par des comètes. Cela provoque des essaims météoritiques, ou « pluies » d’étoiles filantes, qui semblent toutes provenir, par un effet de perspective, du même point du ciel. On appelle ce point imaginaire le radiant. Certaines étoiles filantes ne semblent pas venir du radiant, ce sont des grains de poussière n’appartenant pas au nuage traversé, on les appelle des sporadiques. Ces pluies périodiques d’étoiles filantes portent un nom dérivé de la constellation où se trouve leur radiant. Ainsi, les Perséides (visibles en août) ont leur radiant dans la constellation de Persée.
Pluies — mais d’étoiles; nuages — mais de poussières; essaims — mais de météorides; points imaginaires, effets de perspective, illusions d’optique. L’élément de toute cette astronomie suggestive et irrationnelle qui me convenait le mieux, dont la densité poétique était la plus adéquate à mon idée, était évidemment la constellation de Persée et son essaim visible en août. J’aimais notamment le nom populaire qu’on donne à ce dernier, “les larmes de Saint-Laurent”: un écho de plus, imprévu et providentiel, à la résonance multiple déjà présente dans les définitions de la figure, de la période, des objets célestes. J’aurais peut-être dû en rester là et ne pas faire le tour de réseau destiné à vérifier la disponibilité du titre; La nuit des Perséides n’est pas un concurrent réellement problématique, mais la petite maison d’édition l’est davantage. Et pour le coup son nuage de connotations (poussiéreuses? lumineuses?) était vraiment trop embarrassant: refaire le coup de Seuils, paru au Seuil, passe encore (mais finalement j’en doute: ce n’est pas le genre de choses que peut se permettre un premier livre). Mais l’identité du jeune directeur, le siège de l’entreprise, ça fait un tout petit peu trop non? Sauf à rechercher le happening éditorial, le livre événement (comme Le bon plaisir paru aux éditions Mazarine, jadis). Pourquoi pas. Pour plus tard. Et pour un autre livre que celui dont j’imprime une sortie papier depuis hier soir (ce que c’est long).
En fin de compte l’autre constellation que j’ai choisie a une charge évocatoire aussi dense, sinon plus. Le suffixe ne lui sied pas aussi bien, c’est évident, mais son nom-noyau est beaucoup plus beau. Tant pis pour le moment-clé; novembre peut bien parler d’août.
–
Wordle par E., sur l’état 3 du manuscrit. La définition d’astronomie vient d’ici, tout comme la liste de constellations auxquelles se rattachent imaginairement (illusoirement) les pluies de poussières célestes.
Vu des fenêtres de la salle du troisième étage, à son lever, le soleil paraît tout encombré par les constructions que sa grosse boule rouge finit par surmonter, métamorphosant en gros bilboquet céleste l’escalier en colimaçon qui grimpait le long de la façade du bâtiment d’en face.
Mais ce n’est qu’un souvenir. L’escalier en colimaçon, décrété dangereux, a été remplacé par une structure massive empilant trois énormes pavés de béton où se cache un escalier à rampes rectilignes.
J’imagine le soleil se levant sur ces lieux s’ils étaient aussi déserts que la plaine arctique de Mars; sans doute pas autrefois, car on me dit qu’il y avait ici une grande forêt et non une plaine aride. Alors dans longtemps peut-être, oui, dans très longtemps, lorsque, par exemple, une catastrophe aura vitrifié toute la ville et son campus. Ou dans plus longtemps encore, lorsqu’il aura suffi que l’abandon de tout ce savoir-ci, que l’on sent déjà si bien, aujourd’hui, imprimer sa mélancolie ou son amertume sur l’esprit de ceux qui continuent d’y parler sans trop y croire, lorsque cet abandon aura laissé retourner à la poussière tous les blocs de béton et les escaliers qui s’y cachent.
Mais il continuera d’être rouge, évidemment.
–
Le cliché du lever de soleil sur Mars est sur copié sur le site de la NASA, mission Phoenix - un clic sur l’image pour voir le soleil passer.
Le coeur de réseau a eu un dysfonctionnement logiciel majeur hier midi qui a nécessité son redémarrage à froid.
L’instabilité a commencé vers 12H10 pour se conclure par une indisponibilité totale du réseau, et donc aussi de la téléphonie, vers 12H55.
Après intervention, le réseau est redevenu opérationnel à 13H15 …
… avec des effets de bord, notamment en ce qui concerne les clients légers.
Ça serait un voyage en bateau
Les vents nous portaient avec douceur depuis dix jours. La croisière se passait comme un rêve, même les débutants prenaient plaisir au jeu des voiles et des cordages. Pas une ondée pour leur moisir des nuits qu’ils auraient passées à se blottir en grelottant dans le coin le moins humide de leur couverture. Du coup le grain a surpris tout le monde. Les voiles ont commencé les premières: l’une battait lamentablement le mât, l’autre se tendait à rompre les cordes, et ça claquait cinq minutes par ici, floquait bas cinq minutes par là. Le vent était devenu incompréhensible, changeant de direction et de force beaucoup trop aléatoirement pour adopter la moindre stratégie. Au milieu de la journée, il tomba même complètement, lâchant les voiles du bateau comme des chiffons mous sur les bômes. Le capitaine n’hésita pas bien longtemps à lancer les moteurs de secours, et le voilier, toutes voilures rentrées dans leurs chaussettes, sortit du petit pot-au-noir en un peu plus d’une heure. Mais les passagers avaient maintenant le regard tout angoissé.
Ça serait une alerte incendie pendant l’adagio
Au troisième mouvement c’est fini: les spectateurs ignares ont compris qu’on n’applaudit pas bêtement dès que les musiciens font silence. La montée progressive, très lente, des violoncelles en fond de cordes laisse venir les bois avec toute leur majesté. C’est magnifique. Je n’étais pas allé au concert depuis dix ans, je n’écoutais plus cette symphonie que dans des machines en inox, et j’avais les larmes aux yeux. Les bruits ont commencé dans la coulisse droite; des pas sur les planchers de la scène, des murmures et des voix de plus en plus fortes. Evidemment c’est dans la salle que le désordre a le plus vite pris de l’ampleur: brouhahas, questions étouffées auxquelles un “Je sais pas!” répondait trop haut, remous des corps sur les fauteuils, avec tous les bruits de manteaux, de sacs et de clés. Les musiciens, sur la scène, ont lentement cessé de jouer, ils attendaient déjà l’ordre de se lever quand le directeur de la salle est venu dire qu’il fallait qu’on évacue. Pas un choc de violon ou de tuba sur le bois verni du piano, pas un pupitre renversé: ils se sont levés comme pour saluer, sont sortis par la coulisse gauche dans le plus grand calme. Dans la salle, c’était au contraire la bousculade imbécile. Pressés, écrasés par les hâtifs, certains connards allumaient déjà une cigarette. Sur le trottoir devant l’opéra, ça jacassait sans retenue, ça guettait des fumées, une explosion peut-être? Toute musique évanouie. Mais au moins, quand le directeur a fait revenir tout le monde dans la salle, les musiciens ont repris au premier mouvement. Et il n’y a eu aucun applaudissement intempestif pendant les pauses.
Ça serait une histoire d’amour
Tu m’avais dit que la vie te faisait peur, que tu te sentais tétanisée devant toutes les responsabilités à assumer, les choix à faire, les décisions à prendre, et que tout te dépassait. Mais ce n’était pas grave, tu vois? Moi, rendu tout idiot d’amour, j’étais prêt à faire tout ça pour toi, avec toi. Alors pourquoi m’as-tu trahi? Je ne cherchais qu’à te plaire, qu’à te rassurer, qu’à te consoler, et toi tu rejetais mes conseils tout en disant qu’ils étaient bons, tu continuais de te réveiller dans l’angoisse alors que j’avais passé toute la nuit à t’écrire, tu persistais dans ta jalousie alors que tu savais que je ne vivais plus que pour toi. Pourquoi m’as-tu menti? J’étais fatigué de tes maussaderies, de tes morosités, mais je me battais contre elles, car je voulais plus que n’importe quoi au monde retrouver la si belle aura électrique de tes poèmes et de tes lettres d’amour, je ne pouvais pas vivre sans elles. Pourquoi l’as-tu bradée à d’autres? Je ne voulais même plus te parler. Et je ne sais plus ce que je dois te dire maintenant. Tu pleures encore et tu veux retrouver le son enchanté de nos conversations dans le labyrinthe du désir et des poèmes, mais je ne sais plus comment nous pourrions nous parler, car j’ai perdu l’espoir que nos paroles puissent changer nos vies hésitantes en vies éclatantes. Et souvent, maintenant, ce n’est que le grésillement du téléphone qui enfle dans nos silences, et non plus, comme avant, le larsen insoutenable du désir.
–
La photo est sur http://zabile.free.fr/Montage_PC.htm. La citation émane du responsable réseau de mon principal serveur professionnel, dans un e-mail daté d’aujourd’hui à 9h47.
La convention globale a été signée dans le petit village tri-frontalier en 1985, mais le traité instituant “l’espace de Schengen” a été ratifié à Amsterdam en 1997. Pendant douze ans, et surtout à partir de 1990 (convention de suppression progressive des frontières), des postes ont été supprimés, un peu au hasard. Celui de Bettignies était déjà presque désert quand j’ai reçu ma feuille de route et que je me suis installée dans la petite ville près de la frontière, sur la Nationale 2. Pendant les premiers mois, on a vu quelques douaniers encore, tout fantomatiques dans leur guérite ne relevant même pas la tête quand la voiture passait au pas entre les bâtiment de briques rouges bordant la route. Et puis assez vite, plus personne.
On faisait les 5 kilomètres pour aller acheter l’essence en Belgique, où elle était moins chère. A la frontière, côté belge, il y avait encore quelques bâtisses: un petit commerce de chocolats, deux ou trois baraques de change. C’était déjà tout désolé, comme paysage. Je suppose qu’avec la zone euro et la mondialisation tout le monde est parti, maintenant.
Mais il y a des gens qui vont y faire des photos, à Bettignies, qui font des groupes sur Flickr ou des albums historico-méditatifs. Est-ce que fait vraiment réfléchir à Schengen? Moi j’ai l’impression qu’une fois abandonnés tous les postes frontière prennent des allures assez parentes, comme les friches industrielles. Est-ce que la mémoire si précieuse que nous tentons de garder de nos jeunes années se métamorphosera de même, et se reconnaîtra aussi bien dans la forme exacte de son paysage que dans le dessin d’une Amérique fragile?
Les anthropologues post-modernes disent que les non-lieux sont les aéroports, les hypermarchés, les hôtels. Des trucs de grandes villes. Dans un rayon de dix kilomètres autour de Maubeuge, on pouvait se retrouver dans des espèces de vallons pleins de boue, où la route serpentait en perdant mètre après mètre tout ce qui la faisait ressembler à une route, avant de finir en cul-de-sac dans la cour d’une grande ferme en brique fortifiée tombant en ruine. Des non-lieux ruraux où presque aucun repère (une machine, un panneau, quelque chose) ne permettait de dire qu’on était en 1992 et non en 1930 ou en 1902. Juste cette atmosphère d’abandon universel, à laquelle le passage de la frontière nous accoutumait vite.
–
Le dessin est sur le site d’Aleksandra Sergeevna Zelenina. C’est Koos Fernhout qui a cliché Bettignies. Par le CLANdestin européen on arrive aux albums de Ctortecka et Jostmann: “Schengen - Grenzen”.
 Un extrait de hard science fiction. Un vidéo-projecteur inutilisé. Trois averses de grêle. Une pièce de cinquante centimes tapée à une médiéviste. Un café. Un schéma de théâtre romain. Un bol de riz au beurre. Une citation d’Augustin. L’autobiographie du “nous” et non pas du “je”, les articles critiques sur Proust, le mythe d’Oedipe, le journalisme et la littérature, le puzzle générique de Wittkop, l’ekphrasis durassienne, le road-movie de Nabokov, les règles de l’épopée. Des Argonautes. Une clé bleue. Une photocopieuse en panne. Le sourire du flamand rose, Cantatrix Sopranica L., medea nunc sum, le guerrier, le récit de voyage, Fight Club, Aragon. Evidemment. Quatorze degrés dans le salon.
Un extrait de hard science fiction. Un vidéo-projecteur inutilisé. Trois averses de grêle. Une pièce de cinquante centimes tapée à une médiéviste. Un café. Un schéma de théâtre romain. Un bol de riz au beurre. Une citation d’Augustin. L’autobiographie du “nous” et non pas du “je”, les articles critiques sur Proust, le mythe d’Oedipe, le journalisme et la littérature, le puzzle générique de Wittkop, l’ekphrasis durassienne, le road-movie de Nabokov, les règles de l’épopée. Des Argonautes. Une clé bleue. Une photocopieuse en panne. Le sourire du flamand rose, Cantatrix Sopranica L., medea nunc sum, le guerrier, le récit de voyage, Fight Club, Aragon. Evidemment. Quatorze degrés dans le salon.
Un fait divers médéen.
Rien.
–
Des bouts de Earwig Factory, indezonefont, Kingthings Pique’n'meex, Liquid Newspaper, Odysea Astral et FKAFont Regular — sur Dafont.
 Je vais dans une bibliothèque à l’autre bout de la ville avec S. pour chercher une bande dessinée, je reviens, papa sonne à la porte, je repars dans une autre bibliothèque reporter un disque de Steve Reich, je reviens, Ch. part à l’aéroport, papa discute avec les garçons, Ch. revient avec Valérie, on dîne avec papa, Ian passe avec Jean chercher Ch. et Valérie, les enfants sont contents de le voir et se lèvent de table pour l’embrasser, Ian repart avec Ch. et Valérie, je range la cuisine, papa parle, et à la fin je le conduis à son hôtel. Il reste sur le trottoir jusqu’à ce que la voiture ait tourné le coin de la rue (pour lui), jusqu’à ce que sa silhouette disparaisse du rétroviseur (pour moi).
Je vais dans une bibliothèque à l’autre bout de la ville avec S. pour chercher une bande dessinée, je reviens, papa sonne à la porte, je repars dans une autre bibliothèque reporter un disque de Steve Reich, je reviens, Ch. part à l’aéroport, papa discute avec les garçons, Ch. revient avec Valérie, on dîne avec papa, Ian passe avec Jean chercher Ch. et Valérie, les enfants sont contents de le voir et se lèvent de table pour l’embrasser, Ian repart avec Ch. et Valérie, je range la cuisine, papa parle, et à la fin je le conduis à son hôtel. Il reste sur le trottoir jusqu’à ce que la voiture ait tourné le coin de la rue (pour lui), jusqu’à ce que sa silhouette disparaisse du rétroviseur (pour moi).
La récidive est logée dans l’urètre, et le rein, qui grossit, semble-t-il. Rien n’est sûr. Il aimerait bien que l’opération se passe à la mi-décembre, pour qu’il ait eu le temps de s’en remettre avant de partir cinq semaines là-bas, pour le nouvel an qui sera le 26 et pour dix jours dans la campagne du Nord, il ne sait pas trop comment il ira, mais il a coché les sites sur le cadastre, et il louera peut-être un vélomoteur, il ne sait pas trop.
Comme souvent, pendant qu’il reste debout à regarder jusqu’à sa disparition la voiture (et c’est comme ça aussi quand on repart de sa maison en banlieue), je sais bien que c’est moi qui suis en train de m’éloigner, mais j’ai l’impression que c’est papa qui s’en va.
–
Un bout des falaises d’Etretat dessinées par D. Ehrhard pour Edilarge.